Imaginez une journée de travail qui ne finit jamais… Votre ordinateur reste allumé, les notifications continuent d’affluer, et votre téléphone ne cesse de vibrer avec des messages professionnels.
Ce scénario est devenu une réalité quotidienne pour beaucoup d’entre nous. Le numérique, qui devait nous libérer et nous rendre plus efficaces, a introduit une nouvelle source de stress. Ce phénomène diffus porte un nom, c’est le technostress. Il s’agit du stress provoqué par l’usage intensif, complexe ou mal maîtrisé des outils numériques (Tarafdar, Cooper & Stich, 2019). Il s’accompagne souvent d’un épuisement numérique. Un autre phénomène que l’on peut qualifier comme une fatigue mentale, physique et émotionnelle liée à une exposition prolongée aux écrans et à la sollicitation constante (Turel, Serenko & Giles, 2021).
Ce sentiment d’être submergé par la technologie et cette pression constante d’être toujours joignable ne sont pas anodins. Le technostress au travail touche toutes les couches du monde professionnel, affectant la productivité, la satisfaction au travail et, surtout, la santé mentale des employés (Tarafdar et al., 2019). L’Organisation mondiale de la santé souligne l’urgence d’une intervention structurelle pour protéger la santé mentale des employés, notant que les problèmes de santé mentale au travail sont en augmentation et nécessitent une attention immédiate (WHO, 2022).
« Derrière le mésusage du mail, il y a toujours des problèmes soit d’exigences managériales, de mauvaise organisation du temps de travail, de relations entre les collaborateurs ou encore de surcharge du travail. »
Cindy Felio, 2017
Tweet
Les chiffres sont révélateurs : 21 % des travailleurs canadiens affirment ressentir un stress élevé directement lié à cette surcharge numérique (Statistique Canada, 2023). Par ailleurs, au Québec, près de 40 % des salariés disent ne pas réussir à décrocher en dehors de leurs heures de travail (Malakoff Humanis, 2023). Ce ne sont pas de simples statistiques, mais reflètent des vies affectées, des familles touchées et des communautés impactées. Derrière chaque pourcentage, il y a des individus qui luttent contre l’anxiété, la dépression et l’épuisement professionnel.
Dans ce contexte, cet article propose une analyse critique et humaine du technostress dans le contexte professionnel actuel. Tout d’abord, nous commencerons par examiner comment la technologie, loin d’être neutre, peut devenir une source importante de stress et d’inégalités au travail. Ensuite, nous aborderons les responsabilités des entreprises face à la protection de la santé mentale de leurs employés. Enfin, nous présenterons des solutions concrètes visant à repenser les usages numériques et à adapter les structures organisationnelles pour un environnement de travail plus soutenable, équitable et respectueux des rythmes humains.
Le technostress au travail : un révélateur d’inégalités
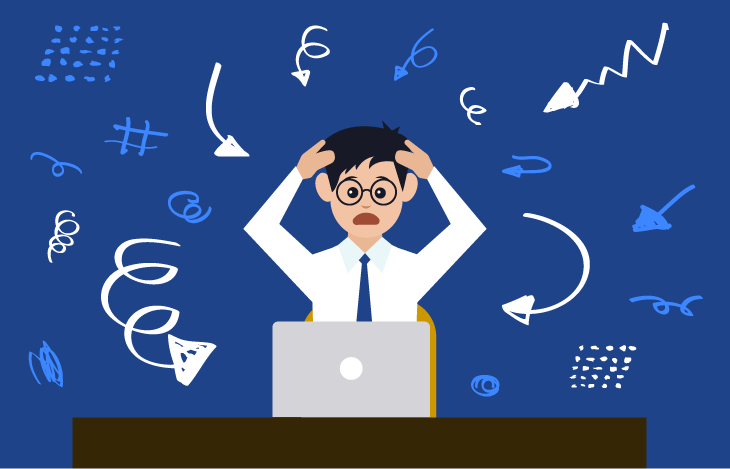
Examinons d’abord trois exemples de personnages fictifs illustrant comment le technostress révèle et amplifie les inégalités sociales et professionnelles. L’accès à un espace de travail ergonomique, à des ressources numériques adaptées, ou à un soutien managérial diffère selon plusieurs facteurs tels que le statut, l’âge ou le genre (Klarsfeld et al., 2024). Ainsi, le technostress ne se limite pas à provoquer de l’épuisement : il creuse aussi les écarts et instaure une forme de discrimination. Une revue récente souligne que focaliser uniquement sur les causes traditionnelles du technostress occulte les inégalités socio-économiques sous-jacentes, renforçant les disparités entre travailleurs (Riedl et al., 2021).
Les gestionnaires : entre responsabilité et hyperdisponibilité
Marie, cadre supérieure, se sent constamment sous pression. En effet, elle dirige une équipe de 20 personnes. Par conséquent, elle doit être disponible à toute heure. De plus, elle gère les crises à distance. Cependant, malgré son engagement, Marie se sent épuisée. Pourtant, elle craint de montrer des signes de faiblesse.
Cette pression est courante parmi les cadres. En effet, beaucoup déclarent un stress élevé et une grande fatigue émotionnelle (Pflügner, 2021). De surcroît, souvent, les cadres sont pris entre le marteau et l’enclume : ils doivent répondre aux attentes de leur hiérarchie, tout en soutenant leurs équipes. Ainsi, cette double pression peut mener à un épuisement professionnel (Nawaz, Zeeshan, & Ahmad, 2023). En outre, elle peut détériorer la santé mentale.
Par conséquent, les entreprises doivent reconnaître les défis uniques auxquels sont confrontés les cadres et leur offrir un soutien adapté. Cela peut notamment inclure des programmes de mentorat, des formations en gestion du stress, ainsi que des ressources pour aider les cadres à établir des limites saines et à déléguer efficacement.
Les jeunes professionnels : toujours connectés
Thomas, 28 ans, travaille dans une startup technologique. Passionné, il reste toujours connecté. Ainsi, il répond aux messages à toute heure. Cependant, cette hyperconnectivité a un prix : il souffre d’épuisement numérique. En effet, il a du mal à déconnecter, même pendant ses vacances. De plus, il se sent constamment sous pression.
Les jeunes professionnels comme Thomas sont souvent vus comme des « digital natives ». Pourtant, cette aisance masque une réelle vulnérabilité. En effet, ils font face à l’hyperconnexion, aux attentes de disponibilité, et à la difficulté de poser des limites (Gallup, 2024). Les jeunes professionnels sont souvent les plus exposés au technostress en raison de leur désir de prouver leur valeur et de leur peur de manquer des opportunités. Ils sont également plus susceptibles de travailler dans des environnements où la culture de la réactivité et de la disponibilité constante est la norme (Gibbs, Mengel, & Siemroth, 2023).
Les entreprises doivent offrir des formations et des ressources pour aider ces jeunes talents à gérer leur temps et leur stress, et à établir des limites saines entre vie professionnelle et vie personnelle.
Les femmes : double charge mentale
Prenons l’exemple de Sophie, cadre dans une entreprise de marketing. En théorie, le télétravail devrait l’aider à mieux concilier vie professionnelle et familiale. Cependant, en pratique, Sophie jongle entre réunions en ligne, emails urgents et devoirs de ses enfants.
Cette double charge mentale pèse lourdement sur sa santé. De plus, elle est exacerbée par la disponibilité numérique attendue dans les modes hybrides. Sophie n’est pas un cas isolé. En effet, les femmes, souvent en première ligne des charges domestiques et parentales, vivent un cumul silencieux entre obligations professionnelles et responsabilités familiales. Cette situation se voit accentuée par la disponibilité numérique, ce qui entraîne une charge mentale accrue et un stress important (Klarsfeld et al., 2024).
Les femmes sont souvent confrontées à des attentes contradictoires : être disponibles pour leur travail tout en assumant la majorité des tâches domestiques et parentales. Cette situation crée un stress constant et une sensation de ne jamais pouvoir satisfaire pleinement ni les exigences professionnelles ni les responsabilités familiales. Les entreprises doivent reconnaître cette réalité et mettre en place des politiques qui soutiennent réellement l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Les entreprises doivent adopter une approche intersectionnelle pour mieux comprendre les multiples facettes du technostress. Nous avons vu que les expériences des employés résultent d’une combinaison de divers facteurs (Bhatt & Kothari, 2022). En prenant en compte ces dimensions dans leur analyse, les organisations sont davantage préparées à élaborer des politiques et des programmes réellement inclusifs. Par conséquent, elles seront en mesure d’offrir un soutien plus ciblé et efficace à la santé mentale de tous leurs collaborateurs, favorisant un environnement de travail plus juste et résilient face aux défis numériques.
Les limites des approches actuelles : entre bonne volonté et injonctions paradoxales
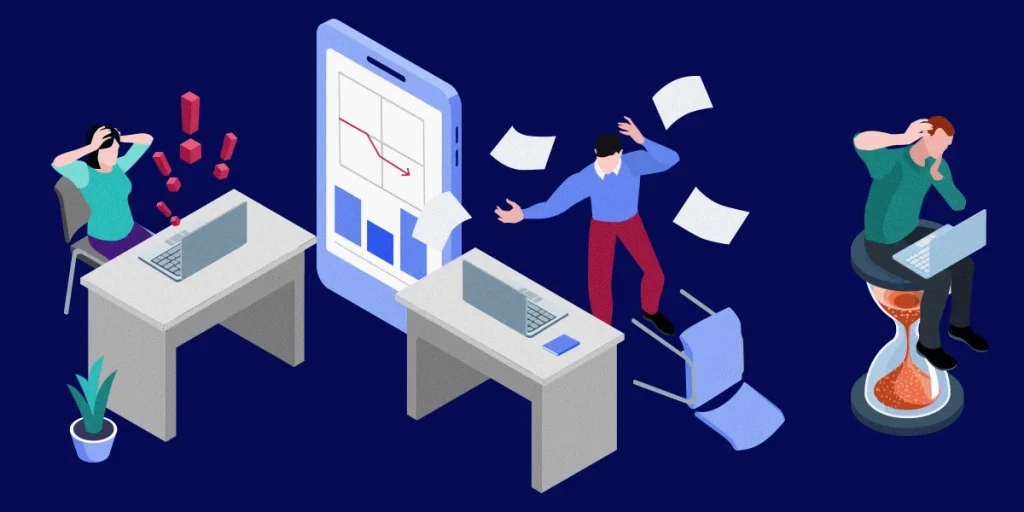
La responsabilisation individuelle et ses limites
De nombreuses entreprises mettent en place des solutions individuelles pour lutter contre le technostress, telles que des sessions de méditation, des webinaires sur la gestion du stress ou l’accès à des applications de bien-être. Ces initiatives apportent un soutien apprécié par les salariés. Cependant, elles restent insuffisantes pour transformer en profondeur l’environnement de travail (Frontini, De Simone, & Borgogni, 2018).
De plus, en se concentrant principalement sur l’individu, ces démarches peuvent parfois masquer les causes organisationnelles du stress numérique (Berger et al., 2024). Sans réels changements structurels, les efforts demeurent limités et ne répondent pas pleinement aux besoins des employés.
Par ailleurs, la bonne volonté des entreprises se heurte souvent à des contraintes systémiques et culturelles, qui maintiennent des conditions de travail stressantes. Il est donc essentiel de dépasser ces solutions superficielles pour adopter des stratégies globales, incluant la révision des pratiques managériales et des attentes organisationnelles (Tarafdar, Cooper, & Stich, 2019).
En définitive, seule une action coordonnée, combinant soutien individuel et réformes structurelles, permettra de réduire durablement le technostress au travail.
La culture de la réactivité
La culture de la performance reste très présente dans de nombreuses organisations. Elle valorise une réactivité constante, vue comme un signe d’engagement et de professionnalisme. Pourtant, cette attente de disponibilité permanente crée des tensions contradictoires (Brecheisen, 2023).
D’un côté, les entreprises proposent souvent des solutions individuelles comme des formations à la gestion du stress ou des outils de bien-être. Elles cherchent ainsi sincèrement à soutenir leurs employés (Frontini, De Simone, & Borgogni, 2018).
De l’autre, ces efforts butent sur des messages contradictoires : on encourage la déconnexion, tout en attendant des réponses rapides et une présence quasi immédiate (Peralta, 2011).
En réalité, ces initiatives, bien que positives, ne traitent pas la cause profonde du problème. Cette contradiction augmente le stress des salariés (Tarafdar, Cooper, & Stich, 2019). Malgré leur bonne volonté, ils se sentent piégés dans un système où les attentes sont floues et parfois incohérentes.
Face à ces limites, il est crucial que les entreprises aillent au-delà de la seule responsabilisation individuelle. Sans changer les pratiques managériales et les structures organisationnelles, les bonnes intentions risquent d’être inefficaces, voire contre-productives (Pflügner, Baumann, & Maier, 2021).
Il faut donc repenser la culture d’entreprise. Cela passe par une clarification des attentes, une réduction des injonctions paradoxales et l’instauration d’un vrai respect des limites personnelles. Ces mesures sont indispensables pour réduire le technostress lié à la culture de la performance rapide (Klarsfeld et al., 2024).
Flexibilité : liberté ou auto-exploitation ?
Les horaires flexibles sont fréquemment vantés comme un avantage majeur pour les employés. Néanmoins, en l’absence de normes bien définies, cette flexibilité risque de se transformer en source d’auto-exploitation. En effet, elle peut entraîner une extension invisible du temps de travail, parfois au détriment du bien-être des salariés (Brecheisen, 2023).
De surcroît, cette absence de limites claires alimente un stress supplémentaire et perpétue une culture où la disponibilité permanente devient la norme tacite. Par conséquent, la flexibilité, sans encadrement approprié, peut nuire autant qu’elle ne profite (Tarafdar et al., 2019).
Dès lors, les entreprises se doivent d’instaurer un cadre strict autour de la flexibilité. Cela comprend notamment la définition de plages horaires précises, l’encouragement à une utilisation raisonnée des outils numériques, ainsi que la garantie effective du droit à la déconnexion (Peralta, 2011).
Par ailleurs, il est indispensable de proposer des formations et des ressources adaptées pour aider les employés à mieux gérer leur temps, à limiter leur stress et à poser des frontières claires entre vie professionnelle et vie privée (Alkhayyal & Bajaba, 2024).
En définitive, seul un équilibre entre autonomie accordée et cadre structurant permettra d’éviter que la flexibilité ne devienne une source d’épuisement.
Les bonnes pratiques : des organisations qui montrent la voie
Pour illustrer comment certaines organisations parviennent à atténuer les effets du technostress, examinons des pratiques organisationelles qui montrent la voie.

Desjardins : cadrer les usages numériques
Cette institution financière basée au Québec a mis en place une politique claire de régulation des communications. Par exemple, elle bloque les emails en dehors des heures de travail et instaure des journées sans réunion. Ces mesures visent à réduire la surcharge informationnelle. Ainsi, les employés peuvent se concentrer sans être interrompus par des notifications ou des réunions. En un an, ces initiatives ont réduit le stress perçu par les employés de 18 % (Desjardins, 2023). Grâce à ce cadre pour les usages numériques, Desjardins a créé un environnement de travail plus respectueux des limites personnelles. Par conséquent, cela favorise à la fois la productivité et le bien-être des employés.

Volkswagen : un signal fort
Dès 2011, Volkswagen a pris des mesures concrètes pour protéger le temps personnel de ses employés. Ainsi, l’entreprise a restreint l’accès aux serveurs BlackBerry en dehors des heures de bureau. Par exemple, l’envoi d’emails est automatiquement coupé après 17h30 (NPR, 2011). Cette politique envoie un signal fort sur l’importance de respecter le temps personnel. De plus, elle permet aux employés de déconnecter complètement après le travail. En limitant l’accès aux outils de communication hors heures de travail, Volkswagen a favorisé un environnement propice à la déconnexion. Par conséquent, cela réduit le stress lié à l’hyperconnectivité et améliore l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
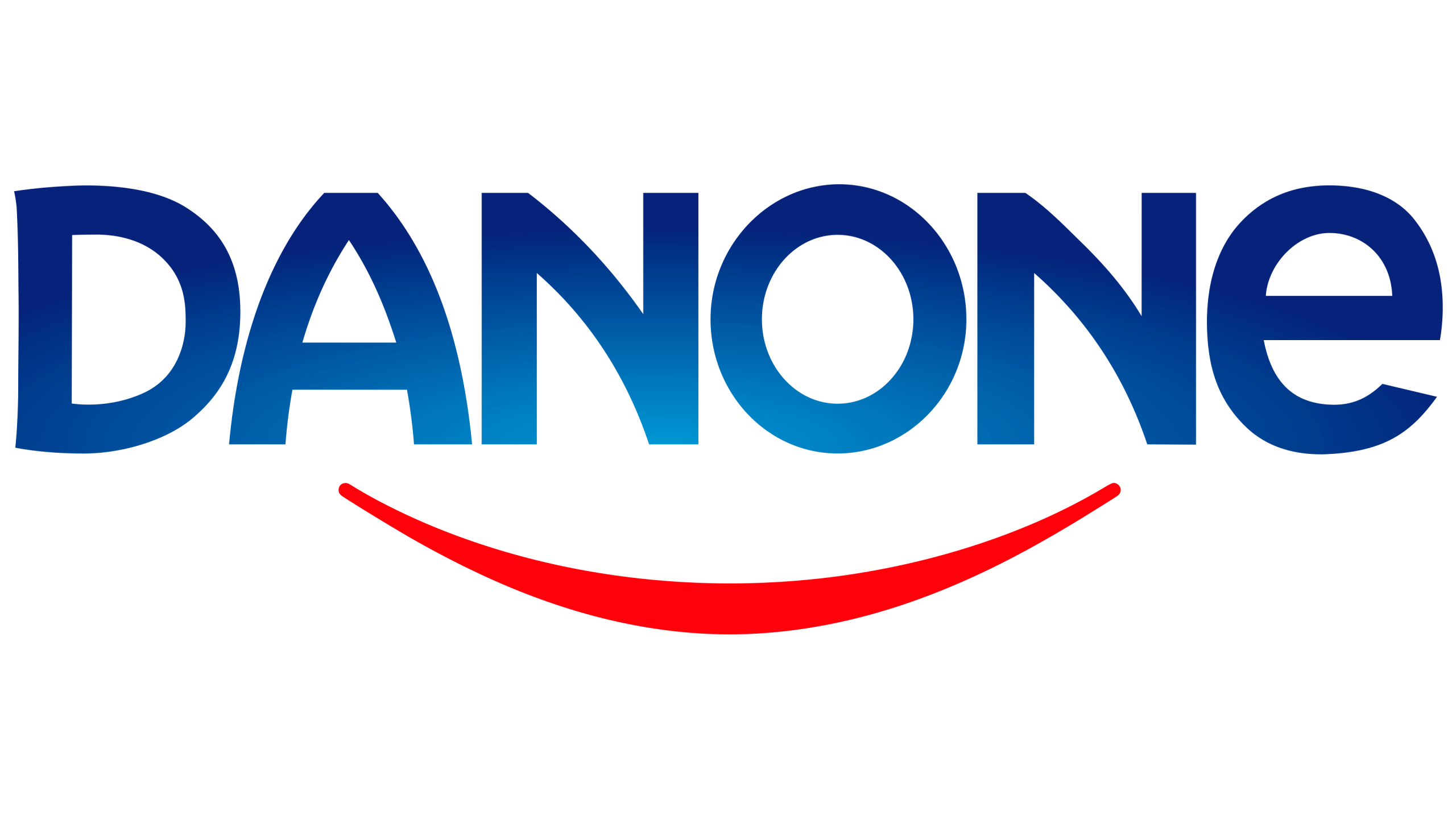
Danone : réconcilier performance et repos
Danone Amérique du Nord a introduit une politique de congés flexibles, appelée “Flexible Time Off”. Cette initiative encourage les employés à prendre du temps pour se reposer sans culpabiliser (Danone, 2024). Ainsi, cette politique promeut une culture du repos et de la déconnexion. Elle reconnaît que le repos n’est pas un luxe, mais une nécessité pour la performance et le bien-être. De plus, en offrant cette flexibilité et en incitant les employés à prendre du temps pour eux, Danone a créé un environnement de travail plus respectueux des limites personnelles. Par conséquent, cette politique favorise une meilleure santé mentale. Grâce à cette approche, les employés se sentent plus reposés et productifs. Enfin, cela démontre que le bien-être des employés est un investissement stratégique pour l’entreprise.
Ainsi, ces exemples montrent l’effet positif de règles claires et de mesures concrètes. Un cadre législatif adapté peut réduire les effets du technostress. Il aide aussi à créer un environnement de travail plus sain. Les besoins des employés sont alors mieux pris en compte.
Cadres législatifs : protéger le droit à la déconnexion
Certains pays ont reconnu l’importance de protéger le temps personnel des employés. C’est le cas de la France, de l’Espagne et de la Belgique, qui ont légiféré sur le droit à la déconnexion. Ces lois montrent que les gouvernements peuvent jouer un rôle clé dans la protection de la santé mentale au travail (Klarsfeld et al., 2024).
France : droit à la déconnexion (Loi El Khomri 2016)
Ce droit impose aux entreprises de plus de 50 salariés de négocier des modalités encadrant l’usage des outils numériques hors temps de travail, afin de préserver l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Belgique : loi 2022 pour la fonction publique, extension au privé en discussion
Depuis février 2022, les agents de la fonction publique ont le droit de ne pas répondre à des sollicitations professionnelles en dehors des heures de travail. Une extension au secteur privé est actuellement en discussion.
Espagne : article 88 de la Loi organique 3/2018 sur la déconnexion
Cette loi encadre la déconnexion numérique en garantissant aux salariés le droit de ne pas être dérangés en dehors de leur temps de travail, tout en imposant aux employeurs l’obligation de négocier des politiques claires à ce sujet.
En reconnaissant ce droit, ils envoient un message fort aux entreprises. Ces dernières sont ainsi incitées à adopter des politiques qui respectent les limites personnelles et soutiennent le bien-être (WHO, 2022). De plus, ces mesures contribuent à poser une norme sociale essentielle : le respect du temps personnel.
Par conséquent, cela aide à réduire le stress lié à l’hyperconnectivité. La qualité de vie des employés s’en trouve améliorée. Ces exemples montrent aussi l’effet positif de directives claires, d’actions concrètes et d’un cadre légal adapté. Enfin, ils rappellent l’importance de créer des environnements de travail sains, centrés sur les besoins réels des salariés.
Vers des environnements numériques plus humains
Pour conclure, dans cette dernière partie, nous explorerons diverses pratiques qui peuvent être mises en place pour protéger la santé mentale des employés.

Au niveau de l’entreprise
Pour créer des environnements de travail plus humains, les entreprises peuvent :
Codifier les usages numériques : par exemple, définir des plages horaires pour les communications et distinguer l’urgence de l’importance (WHO, 2022). Cela passe par des politiques claires sur les heures de travail, la promotion d’une utilisation raisonnée des outils numériques, ainsi que la reconnaissance du droit à la déconnexion (Tarafdar et al., 2019).
Rationaliser les canaux de communication : en réduisant le nombre de plateformes et en limitant les notifications (Gallup, 2024). Cela implique la consolidation des outils, la promotion d’une gestion prudente des notifications, et l’instauration de politiques favorisant la communication asynchrone (Berger et al., 2024).
Former les managers : afin de les aider à détecter les signes de stress et instaurer une culture d’écoute. Pour cela, il est possible de proposer des formations en gestion du stress, des programmes de mentorat et des ressources dédiées au soutien des équipes (Alkhayyal & Bajaba, 2024).
Intégrer des indicateurs de santé numérique : en mesurant le technostress dans les enquêtes de climat social. Cela inclut la réalisation de sondages réguliers, l’analyse des données pour identifier les tendances, et l’utilisation des résultats pour ajuster politiques et programmes (Agogo & Hess, 2024).
Au niveau institutionnel
Les institutions peuvent soutenir et encadrer ces changements de plusieurs façons :
Légiférer pour protéger : il s’agit d’étendre le droit à la déconnexion à tous les secteurs. Cela comprend la reconnaissance légale de ce droit, la mise en place de politiques incitant les entreprises à respecter les limites personnelles, ainsi que la promotion d’une culture valorisant le respect du temps personnel (WHO, 2022).
Créer des labels et incitations : pour récompenser les entreprises qui favorisent un usage sain du numérique (WHO, 2022). Cela peut passer par la création de labels dédiés, leur promotion auprès des consommateurs et investisseurs, et l’offre d’avantages fiscaux ou autres pour encourager l’adoption de ces bonnes pratiques.
Renforcer le dialogue social : l’intégration de l’hyperconnectivité dans les négociations collectives est cruciale pour faire évoluer durablement les pratiques (Klarsfeld et al., 2024). Cela permet de reconnaître ce sujet comme un enjeu de santé et sécurité au travail (Malakoff Humanis, 2023).
Au niveau individuel
Enfin, au niveau individuel, mais jamais isolément, plusieurs actions peuvent être mises en place :
Encadrer les pauses numériques : cela passe par l’introduction de programmes de pleine conscience (Yeniaras & Kisa, 2023). Ainsi, on peut promouvoir des pauses régulières sans technologie, offrir des formations en pleine conscience et gestion du stress, et créer des espaces de travail favorisant la déconnexion et le repos.
Offrir des ressources de soutien : comme le coaching, l’accès à des psychologues d’entreprise, ou encore des plateformes de télé-santé (Alkhayyal & Bajaba, 2024). Par conséquent, cela inclut la mise à disposition de services de coaching et mentorat, l’accès à des professionnels de santé mentale, ainsi que la promotion de solutions numériques offrant un soutien accessible et confidentiel.
Adopter une approche inclusive : il s’agit de cibler spécifiquement les groupes les plus exposés, tels que les femmes et les jeunes professionnels (Gallup, 2024). En effet, cela comprend la reconnaissance des défis uniques auxquels ces groupes font face, l’offre de formations et ressources adaptées, et la promotion de politiques et programmes soutenant leur bien-être et réussite.
Conclusion
Le technostress n’est pas une fatalité. En réalité, il révèle surtout un déséquilibre profond dans notre façon de travailler, où la technologie est souvent utilisée sans limites ni protections. Ainsi, il est urgent de remettre l’humain au centre de nos environnements numériques. Ceci demande un vrai changement : passer d’une culture axée sur la performance constante à une culture qui respecte les rythmes de chacun et le droit au repos.
Par ailleurs, les organisations ne peuvent plus compter sur la seule bonne volonté des salariés. Elles doivent donc prendre leurs responsabilités : établir des règles claires, montrer l’exemple, accompagner et corriger. Ce choix est à la fois moral et stratégique, car l’épuisement nuit à la performance durable. De fait, investir dans la santé mentale est un levier essentiel pour renforcer la cohésion, fidéliser les talents et encourager l’innovation.
Il ne s’agit pas de rejeter la technologie, mais plutôt de l’utiliser de manière plus réfléchie et humaine. Chaque notification, chaque message est reçu par une personne avec ses limites, ses émotions et son besoin de temps. C’est pourquoi c’est ce besoin humain fondamental que nous devons enfin écouter et respecter. En somme, en adoptant une approche globale et inclusive, nous pouvons créer des environnements de travail qui soutiennent à la fois le bien-être et la réussite de tous.

Bibliographie
Alkhayyal, S., & Bajaba, S. (2024). Countering technostress in virtual work environments: The role of work-based learning and digital leadership in enhancing employee well-being. Acta Psychologica, 104377. https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2024.104377
Agogo, D., & Hess, T. J. (2015). Technostress and technology induced state anxiety: Scale development and implications. In Proceedings of the 36th International Conference on Information Systems (pp. 1–11). Fort Worth, Texas. https://www.researchgate.net/publication/282132024_Technostress_and_Technology_Induced_State_Anxiety_Scale_Development_and_Implications
Berger, M., Schäfer, R., Schmidt, M., Regal, C., & Gimpel, H. (2024). How to prevent technostress at the digital workplace: A Delphi study. Journal of Business Economics, 94(5), 1051–1113. How to prevent technostress at the digital workplace: a Delphi study
Bhatt, N., & Kothari, T. P. (2022). Determinants of technostress: A systematic literature review. European Journal of Business Science and Technology, 8(2), 159–171. https://doi.org/10.11118/ejobsat.2022.007
Brecheisen, J., (2023, October 18). Research: Flexible work is having a mixed impact on employee well-being and productivity. Harvard Business Review. https://hbr.org/2023/10/research-flexible-work-is-having-a-mixed-impact-on-employee-well-being-and-productivity
Desjardins. (2023). Rapport de responsabilité sociale et coopérative 2022–2023. Rapport de responsabilité sociale et coopérative 2023
Danone North America. (2024). Flexible Time Off at Danone. Flexible Time Off
Felio, C. (2017). Les conséquences psychosociales de l’usage des écrans au quotidien. AIDSOI. https://doi.org/10.1016/j.aidsoi.2017.07.006
Frontini, R., De Simone, S., & Borgogni, L. (2018). Mindfulness at work: A new approach to improve individual and organizational performance. Frontiers in Psychology, 9, 2569. Preventing Technostress Through Positive Technology
Gallup. (2024). State of the Global Workplace: 2024 Report. State of the Global Workplace Understanding Employees, Informing Leaders
Gallup. (2022, October 27). The future of hybrid work: 5 key questions answered with data. The future of hybrid work
Klarsfeld, A., Carillo, K., Cachat-Rosset, G., Saba, T., & Marsan, J. (2024). Does the welfare regime impact the telework gender stress gap? New Technology, Work and Employment. Advance online publication. https://doi.org/10.1111/Does the welfare regime impact the teleworkgender stress gap?.12287
Malakoff Humanis. (2023). Baromètre annuel sur la santé psychologique au travail. Baromètre Santé des salariés 2023 : derrière un état de santé stable, une santé mentale en berne
Peralta, E. (2011, décembre 23). Work, life balance: VW agrees to switch off after-hours email. NPR. https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2011/12/23/144200222/work-life-balance-vw-agrees-to-switch-off-after-hours-email
Pflügner, K., Baumann, A., & Maier, C. (2021). Managerial technostress: A qualitative study on causes and consequences. Proceedings of the 2021 Computers and People Research Conference, 63–70. https://doi.org/10.1145/3458026.3462157
Riedl, R., Kindermann, H., Auinger, A., & Javor, A. (2021). Is there a sampling bias in research on work-related technostress? A systematic review of occupational exposure to technostress and the role of socioeconomic position. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(4), 2071. https://doi.org/10.3390/ijerph18042071
Statistique Canada. (2023). Enquête sur la santé mentale au travail. Le stress lié au travail est le plus souvent causé par une lourde charge de travail et la conciliation travail-vie personnelle
Tarafdar, M., Cooper, C. L., & Stich, J. F. (2019). The technostress trifecta – Techno eustress, techno distress and design: Theoretical directions and an agenda for research. Information Systems Journal, 29(1), 6–42. The technostress trifecta
Turel, O., Serenko, A., & Giles, P. (2021). Integrating technology addiction and use: An empirical investigation of online auction users. Computers in Human Behavior, 125, 106963. Revealing the theoretical basis of gamification:
World Health Organization. (2022). Mental health at work: Policy brief. Guidelines on mental health at work
Yeniaras, V., & Kisa, S. (2023). The mediating role of psychological resilience on technostress and job performance: A research on academics during digital transformation. Frontiers in Psychology, 14, Article 1252187.Mindfulness and technostress in the workplace: a qualitative approach