Le magasinage en ligne fait désormais partie de notre quotidien. En quelques années, il est passé d’une simple option pratique à une habitude incontournable. Bien que la commodité soit un avantage, elle entraîne également des conséquences : les camions de livraison émettent du gaz carbonique, les emballages jetables s’accumulent et les retours multiplient les trajets. Avec le volume énorme de commandes traitées chaque jour, ces effets prennent une ampleur difficile à ignorer. Peut-on alors vraiment parler de durabilité?
Pour mieux comprendre cette tension, il est essentiel d’aller au-delà du constat général et de creuser trois pistes de réflexion : comparer l’impact réel entre achats en ligne et en magasin, examiner le rôle que pourraient jouer les politiques publiques, et réfléchir à la place du consommateur dans cette équation.

E-commerce vs magasin : une comparaison plus complexe qu’on le pense
On entend souvent que le magasin physique est « plus écologique » que le commerce en ligne, avec moins de cartons et moins de camionnettes dans nos rues. Mais en réalité, tout dépend de la situation.
Par exemple, si je prends ma voiture pour aller acheter un seul article dans un centre commercial à 10 km de chez moi, mon empreinte carbone peut être plus élevée qu’une commande livrée avec d’autres colis dans le même camion. À l’inverse, si je commande plusieurs articles en ligne que je retourne ensuite, l’impact grimpe rapidement. Aux États-Unis, on estime qu’environ 24 % des vêtements achetés en ligne sont renvoyés, et, dans certains segments, comme la fast-fashion ou les chaussures, ce taux peut atteindre 40 %. Chaque retour multiplie les trajets et alourdit d’autant l’empreinte carbone.
Bref, il n’y a pas une réponse simple à la question « qui pollue le plus? ». L’impact dépend surtout de nos comportements : regrouper ses achats, éviter la livraison express et limiter les retours font une vraie différence.
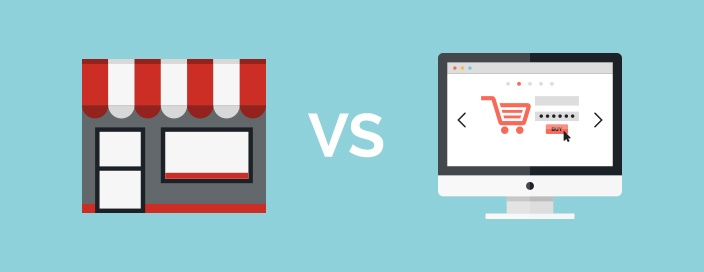
Pourquoi les politiques publiques sont-elles indispensables?
Beaucoup d’entreprises essaient de réduire leur empreinte en investissant dans des véhicules électriques, en rapprochant leurs entrepôts des villes et en utilisant des emballages recyclables. Mais soyons réalistes, ces efforts ont leurs limites. Les coûts sont élevés et la pression des consommateurs pour des prix bas et une livraison rapide reste énorme.
C’est pour cela que les gouvernements jouent un rôle clé dans la transition. L’Union européenne a instauré en 2021 une taxe de 0,80 € par kilo de plastique non recyclé pour réduire les déchets d’emballage. Certaines villes soutiennent directement les commerces : à Leipzig, un fonds de 75 000 € a permis à des petites entreprises d’acheter des vélos-cargos. Certains pays, comme la France, offrent aussi jusqu’à 5 000 € par véhicule électrique pour les flottes de livraison du dernier kilomètre. Enfin, la fin progressive des retours gratuits gagne du terrain : des enseignes comme Zara, Uniqlo ou Boohoo facturent déjà ce service en Europe pour limiter la surconsommation et l’impact environnemental des renvois massifs.
La vraie question, c’est : faut-il imposer des règles strictes ou plutôt donner des incitatifs? Trop de réglementation peut freiner les petites entreprises, mais, sans cadre légal, les gestes volontaires risquent de n’avoir qu’un impact très faible. Une chose est certaine : laisser uniquement les géants du e-commerce décider de la vitesse de transition serait insuffisant. Ils risquent de privilégier leurs intérêts commerciaux plutôt que l’écologie.

Le consommateur : acteur ou spectateur?
Même avec des politiques ambitieuses, rien ne changera vraiment si les consommateurs ne mettent pas la main à la pâte. Cependant, sommes-nous prêts à attendre deux jours de plus pour une livraison plus verte? Et à payer un peu plus cher pour un emballage réutilisable?
Beaucoup affirment dans les sondages qu’ils accepteraient de changer leurs habitudes. Pourtant, dans la pratique, ce sont encore la rapidité et le prix qui dictent les choix. C’est là qu’entre en scène le marketing responsable.
En mettant en avant les livraisons plus lentes (et moins polluantes) avant les livraisons express, en affichant l’empreinte carbone d’une commande ou en rendant la livraison express payante par défaut, les entreprises pourraient influencer nos choix. Cela rendrait visible un coût que l’on préfère souvent ignorer.
Donc, le consommateur doit être responsabilisé, mais il ne peut pas porter tout le poids du problème. Les plateformes ont aussi une responsabilité et doivent innover pour proposer des choix plus durables.

Vers un modèle durable : une responsabilité partagée
Le commerce en ligne n’est pas forcément condamné à rester un symbole de surconsommation. Pour qu’il devienne une option plus durable, il faut toutefois accepter de changer certains réflexes. Acheter en ligne peut parfois avoir un impact moindre que d’aller en magasin, mais seulement si l’on évite les retours à répétition et les livraisons express.
Une chose est claire : il n’existe pas de solution miracle. La transition repose sur un équilibre entre tous les acteurs. Les entreprises doivent investir dans des solutions plus vertes, comme les véhicules électriques ou les emballages réutilisables. Les gouvernements ont la responsabilité d’encadrer les pratiques et de fixer des règles claires. Quant aux consommateurs, ils doivent revoir leurs attentes, puisque vouloir tout, tout de suite et sans frais n’est pas compatible avec un avenir durable.
En fin de compte, la question est simple : sommes-nous prêts à sacrifier un peu de confort pour gagner en durabilité? La réponse déterminera si le commerce électronique devient une partie de la solution ou s’il reste un problème en soi.

Références
Alain Mckenna; Clémence Pavic (septembre 2021), « Consommation : les dangers de la surconsommation en ligne », Le Devoir, https://www.ledevoir.com/economie/628803/consommation-les-dangers-de-la-surconsommation-en-ligne, consulté le 18 octobre.
Alok Paul (mars 2024), « Decoding the art of minimising D2C ecommerce return rates », YourStory, https://yourstory.com/2024/03/decoding-the-art-of-minimising-d2c-ecommerce-return-rates, consulté le 18 octobre.
DLL Group (mars 2023), « A short guide to regulations and subsidies for Last Mile Delivery fleets: A path to electric vehicles », https://www.dllgroup.com/en/blogs/blogsoverview/A-short-guide-to-regulations-and-subsidies-for-Last-Mile-Delivery-fleets-A-path-to-electric-vehicles, consulté le 18 octobre.
DS Smith (mars 2024), « Impact environnemental du e-commerce : le réduire », DS Smith, https://www.dssmith.com/fr/media/actualites/2024/3/impact-environnemental-du-e-commerce-le-reduire, consulté le 18 octobre.
European Cyclists’ Federation (avril 2023), « From sharing schemes to last mile delivery: Leipzig is rooting for cargo bikes », https://www.ecf.com/en/news/from-sharing-schemes-to-last-mile-delivery-leipzig-is-rooting-for-cargo-bikes/, consulté le 18 octobre.
Fondation David Suzuki (s.d.), « Le coût environnemental du magasinage en ligne », David Suzuki Foundation, https://fr.davidsuzuki.org/mode-de-vie/le-cout-environnemental-du-magasinage-en-ligne/, consulté le 18 octobre.
Polyvia (décembre 2024), « Les taxes plastiques en Europe », https://www.polyvia.fr/fr/performance-durable/les-taxes-plastiques-en-europe, consulté le 18 octobre.
Redo Team (novembre 2024), « Returns in the fashion industry: balancing fit, style and sustainability », https://www.getredo.com/en/blogs/returns-in-the-fashion-industry-balancing-fit-style-and-sustainability, consulté le 18 octobre.
Sébastien Lefebure (avril 2023), « E-commerce : la fin des retours gratuits au profit du durable ? », Ecommercemag, https://www.ecommercemag.fr/Thematique/retail-1220/veille-tribune-2169/Breves/E-commerce-la-fin-des-retours-gratuits-au-profit-du-387484.htm, consulté le 18 octobre.

1 commentaire