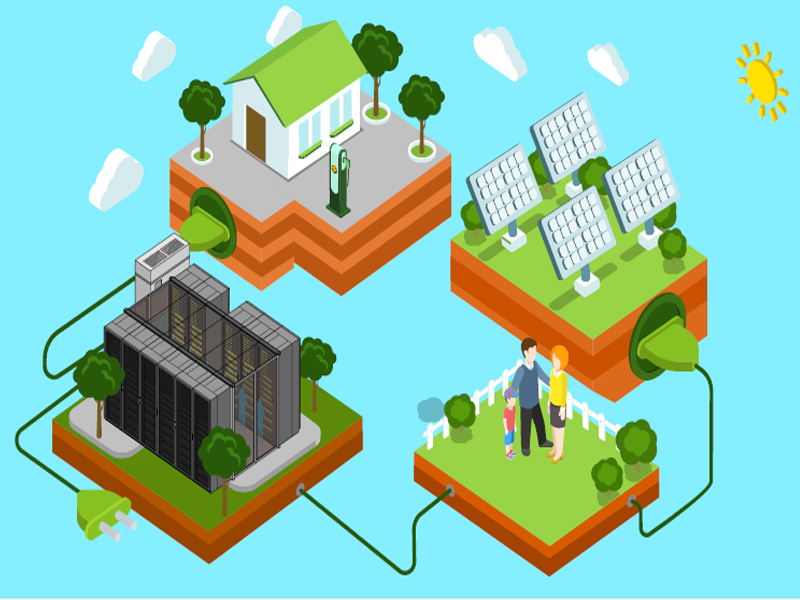Les centres de données verts : un écran de fumée marketing ou vraie promesse technologique?
Nos sociétés connaissent une montée fulgurante de l’usage du numérique. Les centres de données sont devenus les infrastructures invisibles qui soutiennent cette immense économie numérique. Ces centres de données soutiennent l’ensemble des activités numériques, celles ayant les plus grands impacts étant les suivantes : vidéos, streaming, intelligence artificielle et l’info-nuagique. Ces infrastructures ont des impacts négatifs sur l’environnement à court et à long terme. Dans les dernières années, nous avons vu apparaître des nouveaux centres de données dit ‘vert’. Cet adjectif leur est attribué lorsque ces entreprises sont en mesure de démontrer que leurs impacts environnementaux sont réduits à travers diverses innovations. Pourtant, derrière cette promesse de réductions des impacts, semble se cacher une stratégie financière qui va de pair avec les intérêts des actionnaires au détriment de l’environnement et des citoyens. Ces installations ont une empreinte environnementale, notamment en termes de consommation énergétique, d’utilisation excessive de ressources naturelles et d’émissions de gaz à effet de serre.

Dans ce contexte, les initiatives dites “vertes” se multiplient et visent à rendre les centres de données plus durables, en s’appuyant sur des innovations techniques (refroidissement passif, énergies renouvelables, certifications environnementales). Les plus gros joueurs de l’industries, souvent appelé par l’acronyme GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft) ont fait la promesse d’atteindre là carboneutralité et/ou l’objectif de zéro émission. Malheureusement, plusieurs experts chercheurs et ONG soulèvent des alarmes et mettent en cause la crédibilité de ces promesses. Leurs efforts pour l’environnement sont-ils authentiques ou relèvent-ils d’un phénomène de ‘greenwashing’ ?
À partir du constat de ces experts, nous aurons l’occasion d’aller au bout du raisonnement et répondre à la question suivante : les centres de données verts ; un écran de fumée marketing ou une vraie promesse technologique?
Le rapport suivant est structuré en 4 sections :
- La définition d’un centre de donnée vert
- Les enjeux techniques et environnementaux
- Les impacts socioéconomiques et politiques
- Les controverse et limitation de la transition verte du numérique
Qu’est-ce qu’un centre de donnée dit ‘vert’?
Pour bien évaluer la pertinence des data centers dits « verts », il faut d’abord comprendre ce qu’ils sont, comment ils fonctionnent, et ce qui les distingue des centres de données conventionnels. Ces centres sont des infrastructures physiques qui abritent des équipements informatiques tels que des serveurs, des systèmes de stockages et des équipements de réseau ayant pour objectif de stocker, traiter et acheminer des données. Ils fonctionnent 24/7 et ont une demande en énergie énorme et constante.

Nous donnons la désignation de vert à un centre de donnée qui a réussi à minimiser son empreinte environnementale, plus précisément en réduisant sa consommation d’énergie. Soit en utilisant des énergies renouvelables, en optimisant ses systèmes de refroidissement ou bien en comblant ce vide à travers l’obtention de certifications environnementales reconnues à l’international tels que :
- ISO 14064
- RECs (Renewable Energy Certificates) – Amérique du Nord
- PPA (Power Purchase Agreements) – Contrats à long terme avec producteurs d’énergie verte
- GOs (Guarantees of Origin) – Europe
La certification ISO14064 est une certification qui porte sur la quantification et la déclaration des GES. Elle est très importante pour les géants du numérique puisque celle-ci leur permet d’être reconnue comme étant carboneutre, ce qui joue grandement en faveur de leur ‘storytelling’ climatique. Par exemple, Google et Microsoft achètent massivement des crédits carbones depuis le début des années 2010.
Les RECs, PPAs et les GOs, ne sont pas des certifications mais plutôt des mécanismes du marché qui permettent aux entreprises de déclarer qu’elles utilisent des énergies renouvelables et d’obtenir la qualification verte, parfois de manière pas très transparente, Et le tout, malgré le fait que très souvent, l’énergie utilisé provient de sources fossiles!
Ces certifications apportent une légitimité importante, notamment auprès des investisseurs et des grandes entreprises soucieuses de leur responsabilité environnementale.
Malgré les gains financiers clairs lié à l’obtention de ces certifications, beaucoup le font de manière transparente et à travers l’innovation. Dans les dernières années, plusieurs technologies sont mises de l’avant pour permettre l’atteinte des objectifs pour la transition écologique du numérique. Ces compagnies écoresponsables font appels à des techniques de refroidissement par immersion, l’utilisation de l’air extérieur, communément appelé ‘Free cooling’ et/ou la récupération de chaleur. Deux exemples que je trouve intéressant sont les suivants :
- Le centre de données de Facebook à Luleå, en Suède, fonctionne grâce au climat froid local et à de l’électricité renouvelable produite par des barrages.
- Microsoft – Data center de Suède (Gävle et Sandviken), alimenté par de l’hydroélectricité locale, système de refroidissement sans eau potable et l’utilisation de matériaux à faible empreinte carbone


Cela étant dit, tous les efforts actuels de verdissement ne garantissent pas une neutralité environnementale! Nous faisons face à une croissance exponentielle de la demande en données, croissance qui est principalement poussée par l’utilisation de l’IA et de l’infonuagique. Nous devons donc remettre en question l’efficacité réelle de ces démarches entamées par l’industrie du numérique et ainsi pouvoir analyser non seulement les technologies utilisées mais aussi le modèle de croissance sous-jacent. C’est ce que j’aurais l’occasion de développer dans la prochaine section.
Quels sont les enjeux techniques et environnementaux liés aux centres de données?
Comme mentionné ci-haut, malgré tous les efforts actuels pour réduire les impacts négatifs sur l’environnement à travers l’innovation, certaines choses sont hors de notre contrôle. Plusieurs ressources naturelles sont en quantité limitée. La majorité des processus pour l’extraction endommagent l’environnement et contribue aux émissions de GES. Et donc malgré toute la bonne foi possible, cette industrie pose des enjeux techniques et environnementaux qui, dû au fait de sa nature, lui sont intrinsèques.
Le premier enjeu majeur est donc bien évidemment la consommation énergétique. Les centres de données doivent fonctionner en continu, 24/7, pour garantir la disponibilité des services numériques. Cela implique souvent une double consommation : celle des serveurs eux-mêmes, mais aussi celle des systèmes de refroidissement, essentiels pour éviter la surchauffe.
Selon The Shift Project, le numérique représente environ 4 % des émissions mondiales de GES, et ce chiffre pourrait doubler d’ici 2025, en partie à cause des data centers (The Shift Project, 2019). Leur croissance est exponentielle : la consommation électrique des centre de données mondiaux pourrait tripler d’ici 2030, atteignant 1500 TWh par an, soit plus que la consommation annuelle de certains pays.
Le deuxième problème majeur est l’usage intensif de l’eau. Beaucoup de centres de données, par soucis financier, optent pour l’utilisation de refroidissement par évaporation, ce qui entraine la consommation de millions de litres d’eau potable par année et contribue au stress hydrique dans la région!
Sur le plan matériel, l’industrie repose sur l’extraction de métaux rares (lithium, cobalt, etc). Ce processus engendre des impacts sociaux et écologiques considérables, notamment en termes de pollution, de conditions de travail, et de conflits géopolitiques. Jean-Marc Jancovici rappelle que 80 % de l’empreinte carbone d’un ordinateur est générée lors de sa fabrication, bien avant sa mise en fonction — un constat qui s’applique également aux équipements des data centers.
L’obsolescence technologique rapide force les entreprises à renouveler régulièrement leurs équipements pour gagner en performance, ce qui génère une quantité massive de déchets électroniques qui sont souvent très difficiles à recycler.
Et finalement, un des problèmes majeurs qui se posent est le déploiement géographique de ces centres de données. Ils se trouvent souvent dans des pays qui ne peuvent pas encaisser le coup environnemental et donc l’entreprise exploite une réduction de ces opérations en délocalisant à l’international dans des pays moins développés, au détriment des populations locales. Cela pose la question de la cohérence globale de leur modèle, notamment en termes d’infrastructures de transport de données et de souveraineté numérique.
Nous observons malheureusement que malgré leurs efforts en gains d’efficacité, la croissance du volume de données et des usages numériques annule très souvent ces efforts. Ce phénomène porte un nom ; l’effet rebond, qui fait référence au fait que plus les technologies sont efficaces, plus leurs usages augmentent, ce qui entraîne inévitablement une hausse nette des impacts environnementaux.
Quels sont les impacts socioéconomiques et politiques liés aux centres de données?
La documentation sur les enjeux environnementaux des centres de données est large et ce fait depuis plus de 20 ans maintenant. Par contre, ce qui est moins bien documenté, sont les impacts qui s’étendent bien au-delà du domaine de l’écologie. Ces infrastructures, à grande échelle, soulèvent aussi des enjeux socioéconomiques et politiques majeurs, plus précisément en matière de redistribution des bénéfices, de justice environnementale et politique/régulation du numérique. Il est donc primordial d’évaluer les façons de faire de ces géants du numérique.
Il est important de mentionner que l’idée d’une installation d’un centre de donnée est vendue comme une opportunité d’affaire locale non négligeable qui aura des retombés positives sur tous les citoyens, en matière d’emploi et d’économie. Les entreprises promettent des investissements massifs, qui auront pour effet de ruisseler vers le bas. Malheureusement, la réalité est tout autre. Nous observons l’inverse. Les retombées existantes sont limitées et concentrées surtout dans la phase de construction du centre de données. Une fois le tout en opération, le centre requiert en réalité très peu de main d’œuvre qualifié sur place. La très grande partie des profits et des bénéfices est captée par les maisons mères et les sièges sociaux de ces géants du numérique.
Par rapport à un aspect strictement financier, nous observons que ces entreprises se voient octroyer des subventions, des exemptions fiscales souvent sans contres-parties sociales et des tarifs préférentiels sur l’électricité. Cela crée une forme d’inégalité sociale puisque les plus entreprises ayant les plus de fonds monétaire paient peu d’impôts et ont un accès à une ressource hautement stratégique, tandis que les plus petites entreprises, ayant souvent des moyens limités, paient le plein tarif. Sans oublier les citoyens qui ne voient pas la couleur de ces taux préférentiels!
Un autre problème, que nous avons mentionné plus haut, est la répartition géographique des impacts qui soulève une vraie question de justice sociale. Il est difficile de ne pas remarquer que la majorité des centres de données verts sont dans des pays nordiques. L’extraction des métaux se fait cependant dans des pays souvent au sud de l’équateur. Ces pays encaissent la grande partie des impacts négatifs liés aux opérations, en plus d’être aussi prit avec le recyclage et l’enfouissement des déchets électroniques, ce qui crée un stress énorme sur leur environnement local. On voit donc un modèle global asymétrique Nord-Sud qui renforce certaines dynamiques de dépendance entre économie internationale qui sont souvent invisibilisé par les arguments technologiques.
Au niveau politique, l’industrie du numérique fait face a un lobbyisme très puissant et qui a pour objectif de freiner l’adoption de politiques/régulations plus strictes qui ne s’enligneraient pas avec leurs objectifs de revenus. Parmi l’Union européenne, on documente plusieurs initiatives qui pousse dans le sens de la nécessité de transparence des entreprises vis-à-vis leurs émissions et leurs impacts GES. Encore une fois, peu de ces initiatives voient concrètement le jour puisqu’ils se butent toujours à une résistance de la part de grands groupes. Ces groupes préférant l’autorégulation et les engagements volontaires…
Enfin, il est essentiel de rappeler que les choix politiques en matière d’infrastructures numériques ne sont pas neutres. Le soutien public aux data centers dits « verts » repose parfois sur une vision techno-solutionniste : on mise sur l’innovation pour résoudre les problèmes environnementaux, sans remettre en question le modèle de croissance illimitée des usages numériques. Pourtant, comme le rappelle The Shift Project, cette croissance est incompatible avec les objectifs climatiques actuels si elle n’est pas accompagnée d’une véritable sobriété numérique.
Controverses et limites de la transition verte du numérique
Nous voyons bien que malgré les promesses ambitieuses en matière de durabilité, la transition verte des géants du numérique fait face à des critiques de plus en plus fortes. Autant sur la crédibilité par rapport a la faisabilité de ces ambitions et aussi sur l’efficacité réelle de tous ces investissements verts. Les experts, chercheurs et ONG dénoncent d’une voix forte un décalage clair entre le discours de vente/marketing de ces entreprises et la réalité du terrain. Ils soupçonnent donc un phénomène de ‘green washing’ pour améliorer leurs marques de commerces.
Nous avons aussi mentionné les crédits carbones, qui causent eux aussi une controverse fondamentale. Rappelons que ces licences et mécanismes de marché permettent aux entreprises de se vendre comme étant carboneutre, tout en consommant de l’énergie venant de sources fossiles. The Shift Project et Greenpeace dénonce qu’il s’agit là souvent d’une neutralité comptable, qui ne reflète pas du tout une baisse réelle des émissions. Cela permet donc à ces géants de bénéficier de l’image d’une entreprise écoresponsable, sans réellement améliorer ses infrastructures ou investir dans la recherche en innovation.
Et finalement, le dernier problème mais non le moindre, le bon vouloir de l’exécutif et la bonne foi pour la transparence. Cette transparence demeure et demeurera un obstacle immense puisque les objectifs environnementaux vont à l’opposer des objectifs des actionnaires et de l’exécutif. De plus en plus d’entreprises partagent leurs informations sur leurs émissions GES ou bien la consommation d’eau potable, le nombre d’entreprise le faisant étant toujours trop petit. Il y a un manque criant de standardisation de politiques globales et une absence d’indicateurs harmonisés qui nous permettraient de conduire une évaluation objective de la performance environnementale et de pouvoir comparer. Ce manque de transparence crée une opacité qui, à son tour, rend très difficile les efforts menés pour responsabiliser les joueurs du numérique. Ce qui rend l’adoption de nouvelles politiques publiques très difficile.
Conclusion
Il paraît maintenant clair que les centres de données verts ne sont pas la solution miracle et, qu’à eux seuls, ne pourront pas résoudre le défi de la transition écologique qu’engendre le numérique. Nous voyons la aussi un contraste diamétralement opposé : d’un côté des innovations prometteuses et de l’autres un modèle numérique qui repose sur l’utilisation croissante et continue des usages.
Je crois que pour dépasser le phénomène de ‘green washing’, il faut que nous allions, en tant que collectivité, aller au-delà de l’optimisation technique et engager une réflexion systémique sur nos usages numériques, sur la sobriété, et sur la responsabilité des acteurs publics et privés.
Il est important de conclure ici en mentionnant que le numérique a un rôle très important à jouer dans la transition écologique. Cependant, si les impacts qui lui sont liés ne sont pas pris en compte dans nos décisions futures, le numérique risque de devenir l’angle mort de notre transition. Il est donc primordial de combiner transparence des entreprises, une bonne gouvernance des autorités appropriés, des politiques/régulations strictes et saines qui prennent en compte les intérêts de toutes les parties prenantes. Et bien évidemment, l’innovation!
Bibliographie et sources consultées
- The Shift Project. (2019). Pour une sobriété numérique.
🔗 https://theshiftproject.org/article/pour-une-sobriete-numerique/ - Carbone 4 / Jean-Marc Jancovici. (2020). Faut-il croire à un numérique durable ?
🔗 https://www.carbone4.com/publication-numerique-durable/ - Greenpeace (2021). Clicking Green: Who is winning the race to build a green internet?
🔗 https://www.greenpeace.org/usa/reports/clicking-clean-2021/ - SustainIt. (2023). Le guide complet sur les certifications vertes pour les data centers.
🔗 https://www.sustainit.io/blog/guide-complet-sur-les-certifications-vertes-pour-les-data-centers - Microsoft (2022). Building sustainable datacenters in Sweden.
🔗 https://news.microsoft.com/europe/2022/03/01/microsofts-sustainable-datacenter-investments-in-sweden/ - Data Center Frontier. (2023). Inside Facebook’s Luleå data center.
🔗 https://datacenterfrontier.com/facebook-lulea-data-center/ - Nature (2020). Energy and emissions of data centers continue to rise despite efficiency gains.
🔗 https://www.nature.com/articles/d41586-020-02409-7 - European Commission. (2021). Proposal for a regulation on sustainable digital infrastructure.
🔗 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/green-digital-europe - International Energy Agency (IEA). (2023). Data Centres and Data Transmission Networks.
🔗 https://www.iea.org/reports/data-centres-and-data-transmission-networks - Hischier, R., Wäger, P., & Gauglhofer, J. (2017). Environmental impacts of the Swiss data center sector. Journal of Cleaner Production.
🔗 https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.08.020 - Lannoo, B., & Lambert, S. (2020). Power and energy efficiency in cloud computing: a comprehensive survey. Renewable and Sustainable Energy Reviews.
🔗 https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.110667