
Regarder une série sur Netflix, Disney+ ou Amazon, participer à des visioconférences, sauvegarder des recettes ou des fichiers dans le cloud… Tout cela a un coût. Ce coût n’est pas toujours visible sur notre facture mensuelle, mais il est bien réel. Le sujet est aujourd’hui crucial, car la consommation d’énergie liée à ces activités numériques augmente constamment. Il est indispensable de comprendre notre impact environnemental afin de pouvoir agir et le réduire.
Les technologies numériques, de nos téléphones aux centres de données, représentent aujourd’hui environ 3,7 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, soit plus que l’aviation civile mondiale (The Shift Project, 2019). Et le mobile représente plus de 60 % du trafic Internet mondial (Comarketing, 2025). Autrement dit, ce que nous faisons au quotidien comme écouter de la musique, regarder une vidéo ou sauvegarder un fichier a des conséquences bien plus larges a ceux qu’on imagine.

Ce qu’on ne sait pas fait pas mal… vraiment?
J’ai toujours pensé que l’éducation est la base de toute société. Et comme toute base, ses fondations doivent être solides pour permettre un développement durable et sûr. Pourtant, lorsqu’on parle d’éducation en lien avec l’impact que nos actions quotidiennes (numériques notamment) ont sur la planète, les gens se sentent souvent mal à l’aise.
C’est comme si nous ne voulions pas vraiment savoir. Dans mon pays, il existe un dicton bien connu : « ojos que no ven, corazón que no siente. » Ici au Québec, on dirait plutôt : « Ce qu’on ne sait pas fait pas mal. » Et c’est exactement ce qu’on observe au quotidien.
Beaucoup préfèrent fermer les yeux sur la pollution numérique, car y penser nous obligerait à remettre en question nos habitudes : regarder des séries en boucle, stocker des milliers de photos dans le cloud, utiliser l’intelligence artificielle sans modération. Tout cela paraît inoffensif et surtout, très pratique.
Mais derrière chaque clic, On a des infrastructures énergivores, des centres de données qui tournent jour et nuit. Mais, peu de gens en parlent. Pourquoi ? Peut-être parce que, pour plusieurs, mieux vaut ne pas savoir. Savoir, c’est se sentir responsable, et se sentir responsable, c’est devoir changer. C’est inconfortable, alors on évite le sujet.

Éduquer dès le plus jeune âge : une nécessité
Renoncer à ce qu’on aime faire, ou à certains avantages comme ceux offerts par les nouvelles technologies, paraît impensable pour beaucoup. Certains voient même cela comme un retour en arrière. Pour eux, intégrer l’environnement dans notre quotidien, c’est presque nier le progrès.
Mais jusqu’à quel point voulons-nous vraiment savoir les dommages que nous causons ? Combien de temps allons-nous continuer à croire que ce qu’on ne voit pas n’existe pas ?
C’est ici que l’éducation entre en jeu. Elle doit former des citoyennes et citoyens capables de faire des choix conscients, même quand ces choix nous sortent de notre zone de confort. Intégrer ces enjeux, inconfortables ou non dans les programmes éducatifs dès la petite enfance me semble non seulement pertinent, mais urgent.
La France, par exemple, a déjà pris des mesures en ce sens avec la loi Climat et Résilience, qui impose une éducation à l’environnement et au développement durable tout au long de la scolarité il existe des programmes pour les jeunes de différents âges. Son objectif est de les sensibiliser à l’utilisation responsable des technologies numériques et à leur impact sur la santé publique. (Loi n° 2021-1104, 22 août 2021), (Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pèche,2025), parce que si on attend que les adultes changent d’eux-mêmes, on risque d’attendre longtemps. Non faut semer la graine tôt, avant que l’indifférence ne s’installe comme une habitude, et surtout, il faut que cette éducation donne envie d’agir, non pas par peur ou par culpabilité, agir plus par conscience et engagement.
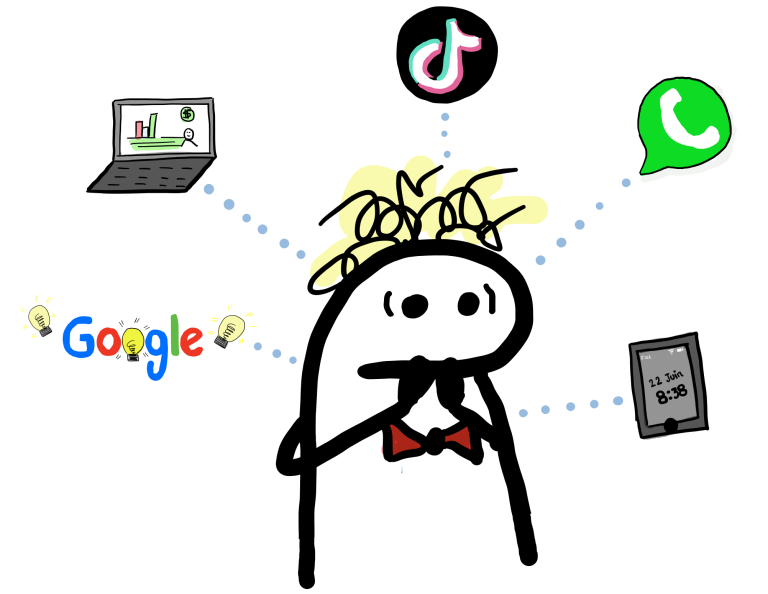
Sobriété numérique
Les usages numériques du quotidien ne peuvent être analysés de façon Independent. Ils sont liés à d’autres enjeux comme la surcharge cognitive, la désinformation, ou encore l’hyperconnectivité au travail.
La sobriété numérique, dans ce contexte, apparaît comme une stratégie globale. Elle ne consiste pas à rejeter la technologie, mais à en faire un usage conscient, raisonné et aligné avec nos valeurs. Cela signifie, par exemple, Garder le plus longtemps possible ses équipements, faire réparer les nos appareils électroniques, éviter d’installer et de faire fonctionner des écrans non indispensables ou bien supprimer régulièrement les fichiers stockés (et qu’on n’utilise pas) dans le cloud (ADEME, 2023)
Mais cette sobriété ne peut se mettre en place sans une éducation aux usages. C’est là où l’école, les institutions, les familles et même les entreprises ont un rôle clé à jouer. Il y a déjà quelques initiatives existent, la ville du Raincy a monté un programme éducatif super intéressant: une semaine sans écrans dans les écoles, du 12 au 16 mai 2025. Le principe ? Sensibiliser les élèves aux dangers des écrans (sommeil, concentration, etc) et leur faire découvrir d’autres activités : jeux, lecture, etc.
La mairie pousse le projet avec les profs, et encourage les familles à le suivre à la maison. C’est une façon d’engager tout le monde dans une utilisation plus saine du numérique (Ville du Raincy, 2025).
C’est avec des pratiques éducatives, avec des enjeux concrets (santé mentale, justice sociale, accès équitable aux ressources, entre outres) que la transition vers des comportements plus sobres peut devenir compressible et désirable pour tous.
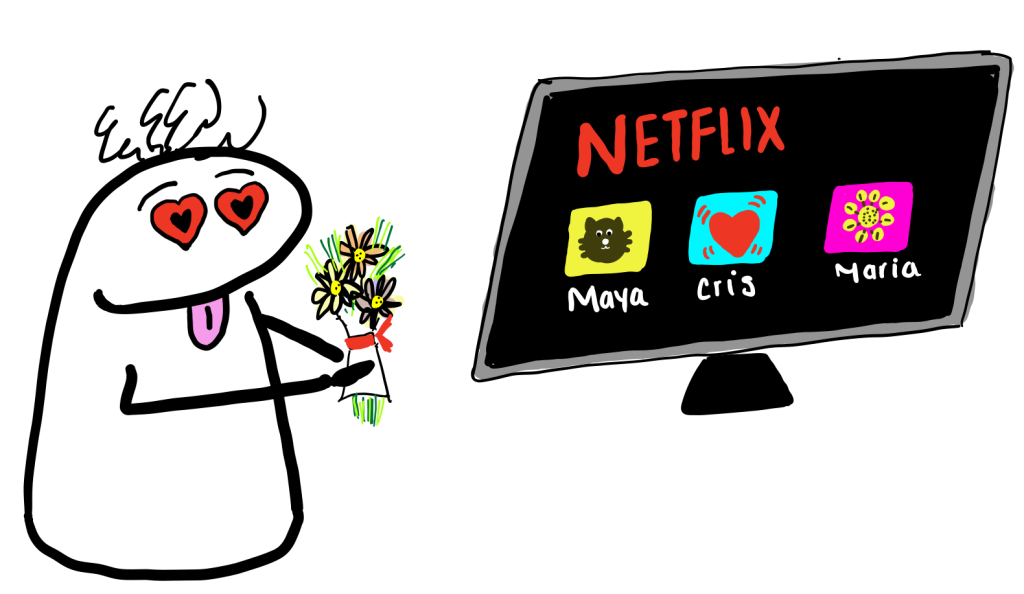
Des tensions, contradictions et défis d’une transition vers la sobriété numérique
Réduire l’empreinte carbone du numérique implique une transition vers la sobriété numérique. Mais cette transition ne va pas sans tensions.
Quand on appel à la sobriété numérique, on trouve plusieurs contradictions. D’un côté, il y a des grandes entreprises technologiques qui affichent de plus en plus leur engagement environnemental. Par exemple, Google annonce utiliser 100 % d’énergies renouvelables pour sept ans consécutives (Google Sustainability Report, 2024), mais ces efforts sont-ils suffisants face à une demande toujours croissante ? Selon une étude du Shift Project (2021), l’efficacité énergétique à elle seule ne compensera pas la hausse exponentielle des usages numériques. En d’autres termes : « On ne peut pas résoudre un problème de surconsommation par la seule efficacité technique. »
D’une outre cote et au même temps, ces entreprises incitent à une consommation croissante développant d’offres illimitées et de contenus personnalisés créés pour maximiser le temps passé en ligne des gens.
Il y a également des tensions culturelles : dans une société où la performance, la rapidité et la connectivité sont valorisées, adopter une posture plus lente et plus réfléchie demande un changement de paradigme profond.
En plus, il existe une inégalité structurelle entre les pays développés et ceux en train de développement. Tandis que les pays riches se préoccupent de la sobriété, d’autres régions du monde luttent encore pour un accès à Internet. Imposer une réduction de consommation de manière uniforme peut être perçu comme une forme de Colonisation numérique. On doit tous fournir des efforts ? Dans quelle proportion?
Parallèlement, il y a un débat sur la responsabilité individuelle versus collective. Doit-on changer nos comportements en tant qu’utilisateurs ou faut-il qu’il existe des régulations plus rigoureuses sur la consommation numérique ? Quelle est la responsabilité du gouvernement ou des entreprises sur ce sujet-là ? Les entreprises peuvent s’engager dans une démarche bas carbone, avec des actions claires comme l’éco-conception (réduire l’impact environnemental dès la création des produits), Sensibilisation (former employés et fournisseurs aux bonnes pratiques) et Compensation carbone (financer des projets de reforestation), le changement climatique est un défi mondial. Chaque pays doit agir pour limiter les effets du réchauffement (Global climate iniciatives, 2023)
Enfin, la sobriété numérique entre parfois en contradiction avec l’innovation. Comment concilier progrès technologique et réduction de l’empreinte écologique ? Doit-on ralentir l’innovation pour préserver la planète ? Ces questions soulèvent des dilemmes éthiques, économiques et politiques encore peu traités dans le débat public.

Doivent les entreprises repenser leur model?
Certaines organisations, entreprises et collectivités ont commencé à prendre conscience de l’urgence environnementale liée au numérique. Bien que les actions restent encore limitées, plusieurs initiatives méritent d’être soulignées comme des pistes concrètes vers une sobriété numérique.
OVHcloud, entreprise française spécialisée dans l’hébergement et les services cloud, Ils fabriquent leurs propres serveurs et data centers depuis 20 ans avec une approche durable: refroidissement à l’eau, composants réparables et contrôle strict de leur impact. Face à la croissance du numérique, ils innovent pour un cloud plus responsable, moins d’énergie, moins de gaspillage.
Dans certaines villes, comme Lausanne (Suisse), Des administrations ont commencé à simplifier leurs systèmes informatiques pour les rendre moins lourds et plus écologiques. La ville a aussi supprimé des courriels archivés et optimisé ses systèmes de visioconférence pour réduire leur impact environnemental. Ce type d’exemple montre que les collectivités peuvent agir directement sur leur empreinte, sans investissements massifs (Ville de Laussane,2025).
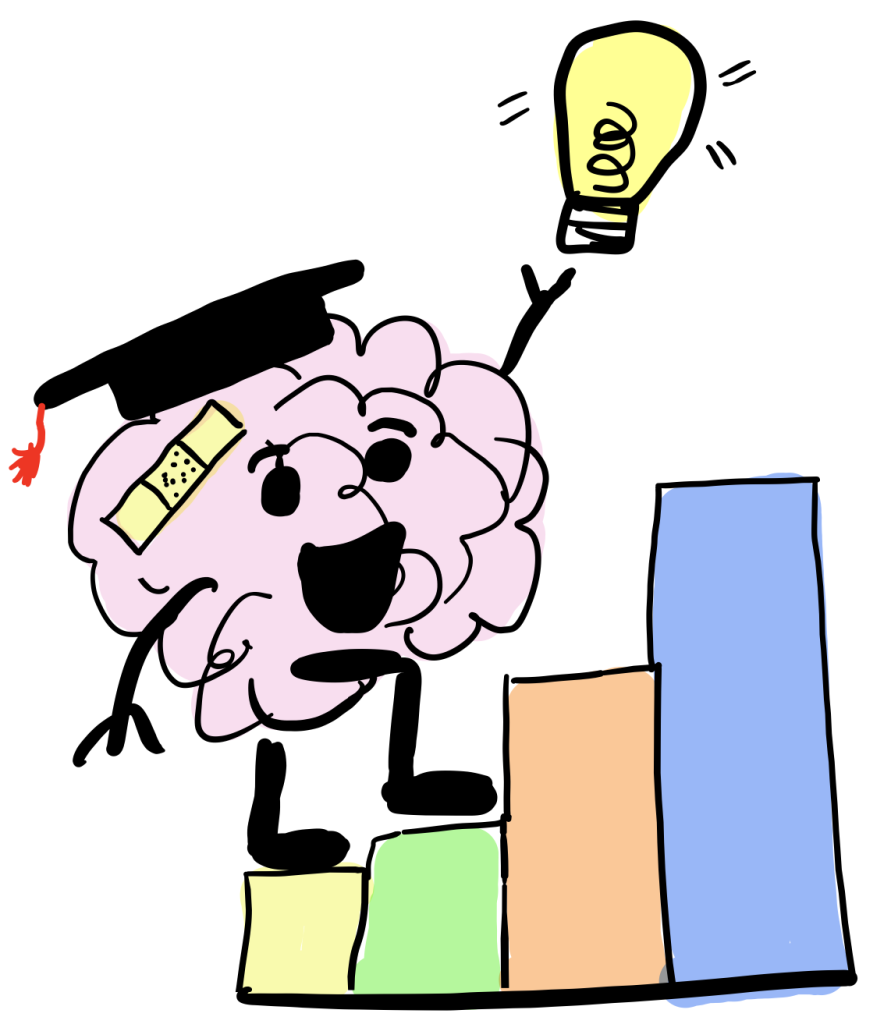
L’enseignement supérieur comme levier
Plusieurs universités canadiennes jouent un rôle clé dans la sensibilisation à la sobriété numérique. Par exemple, l’Université de Waterloo a lancé en 2023 un projet : Accelerating Climate Education, intégrant la durabilité et l’éthique numérique dans des programmes d’ingénierie, comptabilité et urbanisme (Université of Waterloo,2025) Des groupes de travail collaborent avec des enseignants et des étudiants pour ajouter ces contenus au programme, notamment via des projets concrets comme des hackathons sur le climat.
En 2024, Concordia university (Montréal) a mis en œuvre le projet “Sustainability in Curriculum”, ils ont déjà 15 cours remaniés pour y inclure des enjeux de durabilité et d’éthique numérique De plus, en janvier 2025, la publication d’un pressbook interactif permet aux enseignants d’intégrer la durabilité dans leurs cours (Concordia university,2025).
Chez nous, ici, HEC Montréal a intégré des modules sur la durabilité numérique dans ses cursus en gestion et technologies. En tant que étudiants on peut apprendre à évaluer l’empreinte écologique de stratégies digitales (campagnes marketing, chaîne logistique numérique, infrastructures cloud, etc) à travers des cas réels et projets pratiques, on est plus conscientes sur la consommation énergétique dans nos futures décisions professionnelles, un cas concret vers la culture de sobriété.
Ces initiatives montrent comment l’enseignement supérieur devient un véritable tremplin pour sensibiliser et former la relève à des usages numériques responsables, en combinant savoirs, réflexions éthiques et actions concrètes.

Vers une sobriété numérique accessible et désirable
Après avoir analysé les tensions, les exemples concrets et les approches éducatives, il est essentiel de proposer des solutions concrètes et durables pour accompagner une transition vers une sobriété numérique réaliste et applicable, sans compromettre les avantages du numérique. Voici quelques pistes structurées autour de quelques axes principaux : la responsabilité individuelle, les actions collectives et le rôle des institutions.
Le pouvoir des petits gestes
Même si l’enjeu peut paraître vaste, chaque citoyen peut jouer un rôle en adoptant des gestes numériques plus sobres :
- Réduire la qualité par défaut des vidéos regardées en streaming : une résolution de 480p ou 720p sur mobile.
- Limiter les envois de pièces jointes volumineuses ou les newsletters automatiques.
- Faire le tri dans ses fichiers et courriels, afin d’alléger le stockage inutile dans le cloud.
- Utiliser des moteurs de recherche alternatifs, ou des applications qui mettent en avant l’empreinte carbone.
- Allonger la durée de vie des appareils numériques : Donner une deuxième ou même une troisième opportunité aux appareils, faires des petites réparations, privilégier l’achat d’occasion ou reconditionné, utilisation de coques protectrices.
- Utiliser le mode sombre, réduire la luminosité de l’écran ou désactiver les notifications push : des gestes simples qui économisent aussi de l’énergie. ADEME, 2022 ; The Shift Project, 2021.
Tous ces petits gestes peuvent sembler isolés et peu utiles pour la planète. Mais, si chacun adopte le même comportement face aux appareils, l’impact collectif pourra devenir visible, significatif et déterminant pour la planète…et pour le portefeuille !
Responsabiliser les organisations
Les entreprises, universités, écoles et administrations publiques ont un rôle central à jouer dans cette transformation :
- Mettre en place des politiques internes de sobriété numérique comme la formation du personnel, suppression des pièces jointes qui ne sont pas nécessaires, etc.
- Favoriser des fournisseurs engagés dans des pratiques écologiques : centres de données utilisant des énergies renouvelables ou basse consommation.
- Réaliser des audits d’impact numérique incluant le scope 3, pour mesurer les émissions liées à leurs infrastructures, campagnes marketing, plateformes cloud, visioconférences, etc. La seule façon d’améliorer ces indicateurs est de prendre des mesures concrètes. Il faut d’abord avoir une connaissance suffisante pour pouvoir mettre en place des actions éco-responsables efficaces.
- Éviter le greenwashing, en assurant une traçabilité des engagements écologiques (labels, certifications, rapports d’impact).
Soutenir l’action politique et institutionnelle
Pour que la sobriété numérique devienne un enjeu sociétal, les gouvernements et collectivités doivent encadrer, réguler et sensibiliser :
- Encourager la recherche publique et interdisciplinaire sur les impacts du numérique (écologiques, sociaux, psychologiques).
- Instaurer des réglementations plus strictes sur l’obsolescence programmée des équipements et favoriser l’économie circulaire.
- Imposer une transparence carbone sur les plateformes numériques : nombre de données utilisées, consommation énergétique associée.
- Inclure la sobriété numérique dans les programmes scolaires, dès l’école primaire, en l’articulant avec l’éducation à l’environnement et aux médias.
- Subventionner les initiatives citoyennes ou locales qui favorisent une utilisation raisonnée des technologies.
En France, la loi REEN (Réduction de l’empreinte environnementale du numérique) est entrée en vigueur en 2021. Elle impose aux collectivités de former leur personnel à la sobriété numérique et encourage l’évaluation de l’impact environnemental des systèmes d’information.
Pour conclure sur une transition possible et souhaitable
Toutes ces petites habitudes numériques comme regarder une série, écouter une chanson plusieurs fois, participer à une visioconférence ou sauvegarder des fichiers « au cas où » nous semblent naturelles. Elles font partie de notre quotidien, et parfois, on ne les questionne même plus. Pourtant, chaque action a un coût. Pas forcément visible sur notre facture, mais bien réel pour la planète.
Derrière le confort de notre vie connectée, se cache une consommation d’énergie importante. Le streaming, le cloud et les visioconférences mobilisent des ressources qui, si elles restent invisibles à nos yeux, ont un impact direct sur l’environnement. Alors, que faire ? Faut-il tout arrêter ? Bien sûr que non. Le numérique fait partie de notre monde et apporte aussi beaucoup de bénéfices.
Mais il est temps d’agir avec plus de conscience. L’éducation et la sensibilisation sont des clés pour encourager des pratiques plus responsables. Il ne s’agit pas de renoncer au progrès, mais d’apprendre à l’utiliser autrement. Repenser nos habitudes, comprendre ce qu’il y a « derrière l’écran », et transmettre ces connaissances dès le plus jeune âge peut faire toute la différence.
Personnellement, je veux faire partie de cette génération qui ne fermera pas les yeux. Une génération qui pense non seulement à son confort et à l’accessibilité de tout, mais qui va plus loin. Qui regarde attentivement ce qui se cache derrière nos écrans, qui entend la voix désespérée d’une planète qui réclame solidarité et justice. Nous n’avons pas une planète de rechange. Nous n’en avons qu’une. Et si nous commencions, chacun à notre rythme, à modifier ne serait-ce qu’un peu nos habitudes de consommation numérique ?
Changer ne signifie pas tout abandonner. Cela veut simplement dire faire des choix plus éclairés, plus justes, plus durables. Parce qu’au fond, ce que nous faisons aujourd’hui ou ce que nous refusons de voir, déterminera ce que vivront les générations de demain.
SOURCES
ADEME(2023,Nov ). 10 gestes de sobriété numérique pour tous.Récupéré sur https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/5885-10-gestes-de-sobriete-numerique-pour-tous.html?
Comarketing (2025 février 25). Nouveau record pour l’Internet mobile dans le monde.Récupéré sur
https://comarketing-news.fr/nouveau-record-pour-linternet-mobile-dans-le-monde/
Concordia university (2025). Sustainability in Curriculum Progress.Récupéré sur
https://www.concordia.ca/sustainability/about/action-plan/progress-updates/curriculum.html
Global climate iniciatives, (2023). IPCC report: Issues, findings and actions for companies.Récupéré sur
https://globalclimateinitiatives.com/en/rapport-giec-enjeux-actions-entreprises/
Google Sustainability (2024). Environmental Report. Récupéré sur
https://www.gstatic.com/gumdrop/sustainability/google-2024-environmental-report.pdf
Loi n° 2021-1104(2021, Août 22).Récupéré sur
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924).
Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pèche(2025, janvier 24). L’éducation à l’environnement et au développement durable.Récupéré sur
https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/leducation-lenvironnement-developpement-durable
OVHcloud (2023). Managing our environmental impact every step of the way.Récupéré sur
https://corporate.ovhcloud.com/en/sustainability/environment/
The Shift Project (2019, March ). Lean ICT: Towards digital sobriety.Récupéré sur
https://theshiftproject.org/en/publications/lean-ict/
The Shift Project (2021). Récupéré sur
https://theshiftproject.org/article/climat-insoutenable-usage-video/
Université of Waterloo (2025). Accelerating Climate Education. Récupéré sur
https://uwaterloo.ca/accelerating-climate-education/curriculum-revisions
Ville du Raincy (2025). Semaine sans écran: sensibiliser les élèves à un usage raisonné du numérique. Récupéré sur
Ville de Laussane (2025). Numérique responsable. Récupéré sur